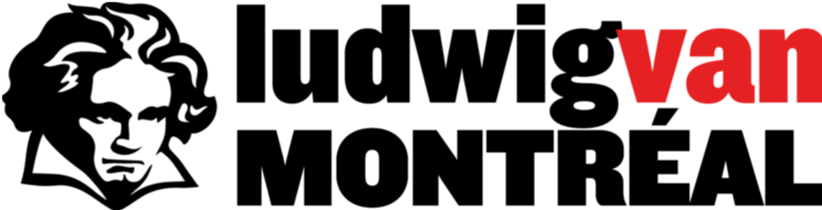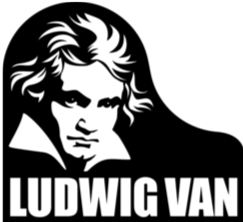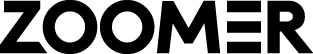Étant de nature à rechercher le positif en toute chose, je n’ai pas souvent écrit de critiques négatives dans ma carrière. Toutefois, avec Champion, présenté jusqu’au 2 février et dont la première avait lieu hier soir à l’Opéra de Montréal, je dois m’avouer vaincue par K.O. Cet opéra est un four. À moins d’être dans une phase de curiosité masochiste, je ne recommande en aucun cas d’y aller.
Commençons par les fleurs. Sur le plan visuel, la production est très réussie avec des projections imaginatives et dynamiques, des éclairages créatifs et de beaux costumes. Dans l’ensemble, tous les chanteurs sont talentueux et investis dans leur rôle. Ce n’est donc pas leur faute si Champion est un pénible échec. Ils font avec ce qu’ils ont, et voilà bien le problème: ils n’ont pas grand-chose, car voilà une oeuvre assez pauvre en contenu.
Après les fleurs, le pot. Champion cultive l’art de mal exploiter son sujet, pourtant un sujet en or. La boxe à l’opéra: ce serait original si l’on nous parlait au moins de boxe. L’homosexualité à l’opéra: ce serait intéressant si l’on explorait vraiment la psychologie et le développement d’une relation entre deux personnages, au lieu de l’aborder de façon superficielle à la toute fin, comme s’il s’agissait d’un élément secondaire alors qu’elle devrait s’inscrire au cœur même des forces qui motivent Emile Griffith, le héros, campé par le baryton-basse Aubrey Allicock. Tout demeure en surface.
En ce qui concerne Emile Griffith, le terme anti-héros serait plus juste, car il apparaît, dans sa version jeune, comme faible et unidimensionnel. Un être sans personnalité, manipulé par les autres, qui ne démontre aucun caractère et n’a pas son mot à dire dans son propre destin.

Quant à sa version âgée, homme souffrant de démence confiné à sa chambre, c’est l’un des personnages les plus déprimants qu’il m’ait été donnés de voir et d’entendre à l’opéra. Dès la première scène, on comprend que la soirée sera pénible alors qu’il chante des lignes variant autour de « où est mon soulier? » pendant cinq minutes. La basse Arthur Woodley, qui l’incarne, mérite une médaille pour avoir donné vie avec conviction à des paroles aussi ennuyeuses.
Car c’est là bien là l’un des problèmes majeurs: le livret de Michael Cristofer est nullissime. En la matière, on croyait avoir touché le fond avec le livret de JFK, mais apparemment, non. On a ici un auteur qui, à notre époque, a écrit les paroles d’un air (chanté par Catherine Daniel, en Emelda Griffith) presque entièrement basé sur des mots qui finissent en « ity »: flexibility, virility, mortality, animosity… au secours!
Faiblesse de la partition
Champion raconte l’histoire tragique du boxeur homosexuel Emile Griffith, qui a causé la mort de son rival Benny Peret JR, lors d’un combat, et vécut le reste de son existence accablé par un sentiment de culpabilité.
Dans sa structure, l’opéra alterne entre des scènes dramatiques et des tableaux animés où débarquent une foule de personnages secondaires, choristes et danseurs aux costumes multicolores: dans une boîte de nuit, dans l’île de Saint-Thomas, dans une discothèque. Ces scènes bourrées de clichés ne font pas nécessairement progresser l’action. À vrai dire, l’oeuvre entière est bourrée de longueurs et après l’entracte, on espère à tout moment que cela va finir, mais en vain : ils remettent ça avec une énième scène inutile qui ne fait qu’étirer la sauce. Cette soirée interminable, en incluant l’entracte, durera 2 h 45.

Parlons de la musique. On le sait, Terence Blanchard, le compositeur, est un trompettiste jazz. S’il a contribué de façon significative à ce genre musical, de dire que l’orchestration ne fait pas partie de ses forces est un euphémisme.
Sous-exploités, on imagine que les musiciens de l’OSM, dirigés par George Manahan, doivent s’ennuyer à mourir avec cette partition redondante et anémique qui n’assume pas le mélange des genres qu’elle est supposée être. Tant qu’à intégrer des éléments de jazz et de blues, on aurait pu y aller plus franchement. À n’en pas douter, l’histoire bouleversante d’Emile Griffith aurait été mieux servie par un « musical » à la sauce Broadway que par cette oeuvre mi-figue, mi-raisin.
Sur les plans harmonique, rythmique et mélodique, bien peu de choses retiennent notre intérêt. Cette faiblesse musicale explique certainement pourquoi on s’attache peu aux personnages. À l’opéra, il est difficile de ressentir des émotions quand la musique échoue à la transmettre adéquatement. Tout tombe à plat, ou presque.
Seules exceptions: l’intervention touchante du jeune Nathan Dibula (Emile Griffith enfant), choriste des Petits Chanteurs du Mont-Royal, qui chante avec sincérité un air émouvant d’une très jolie voix. On a aussi droit à un duo convaincant, devenant un trio, entre Sadie (Chantal Nurse) et Emelda (Catherine Daniel) rejointes par le boxeur. Le chœur final est également réussi.
Au sein de la distribution, soulignons les excellentes prestations du baryton Brett Polegato, savoureux en Howie Albert, manufacturier de chapeaux qui devient l’agent du boxeur, et du ténor Asitha Tennekoon en Luis Griffith, deux chanteurs que l’on souhaite réentendre. Leur forte présence sur scène fait partie des rares éléments emballants de la soirée. Quant à Aubrey Hallicock, qui incarne le personnage principal, son interprétation n’est pas aussi convaincante qu’on l’aurait souhaité, car elle manque de nuances et d’émotions.
On salue la volonté de l’Opéra de Montréal de nous présenter des oeuvres nouvelles provenant des États-Unis. Toutefois, (sans jeu de mot) entre le véritable coup de poing que fut Dead Man Walking en 2013, et Champion, le niveau des opéras choisis n’a fait que baisser. Espérons que ce sera mieux l’an prochain. De toute façon, on peut difficilement avoir pire.
Vous voulez quand même y aller? D’autres représentations auront lieu les 29 et 31 janvier, et le 2 février. DÉTAILS.
LIRE AUSSI:
LISZTS | L’homosexualité à l’opéra: 15 exemples d’art lyrique arc-en-ciel, d’hier à aujourd’hui