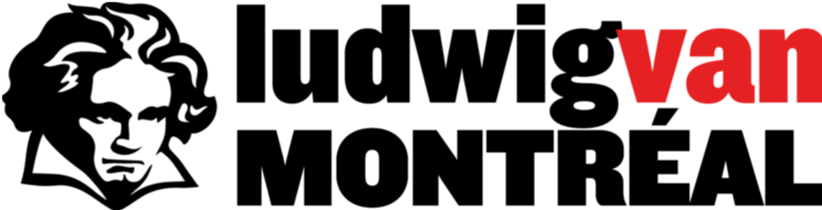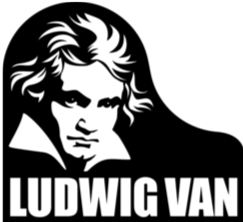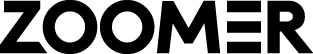Le pianiste islandais Vikingur Olafsson est un bâtisseur de cathédrale : ses programmes sont conçus comme de grands édifices sonores érigés au fil du récital. Lors de sa première venue à Montréal il y a deux ans, il avait impressionné par sa conception à grande échelle des Variations Goldberg, soutenue par une exécution technique impeccable et des choix interprétatifs hautement personnels. Toutes ces caractéristiques ont été confirmées par le récital Bach-Beethoven-Schubert dont il a donné deux représentations à la Salle Bourgie, vendredi et samedi derniers.
Les Variations Goldberg sont, bien sûr, à la base une œuvre de conception unie. Olafsson en faisait ressortir l’organisation sous-jacente en regroupant certaines variations entre elles et en reliant les assemblages obtenus par un sol discret soutenu à la pédale. Il va encore plus loin avec le programme de sa tournée actuelle en enchaînant cinq pièces distinctes en un parcours de 80 minutes non interrompues. Le Prélude en mi majeur du premier livre du Clavier Bien tempéré de Bach sert de mise en bouche à la Sonate no 27, op. 90 de Beethoven, suivie de la Partita no 6 en mi mineur, BWV 830, et de la Sonate D. 566 de Schubert. Ce parcours en mi, majeur et mineur, atteint sa destination avec la Sonate no 30, op. 109 de Beethoven, à laquelle Olafsson choisit volontairement d’accorder la fonction de destination, et non de point de départ, comme c’est souvent le cas.
Même une fois révélée dans son ensemble, la cathédrale d’Olafsson n’est pas facile à saisir. À l’écoute, on se heurte à des détails d’exécution hétéroclites et surprenants. L’élément le plus détonnant est le romantisme à fleur de peau de l’interprète, qui fait chanter exagérément les lignes de Bach et Beethoven. La Sonate no 27 de Beethoven en est la plus affectée, devenant presque méconnaissable à force d’en gommer les contours dans un lyrisme sirupeux. La Sonate de Schubert conserve au contraire une simplicité ne la privant en rien de son pouvoir expressif. Le deuxième mouvement (Allegretto), en particulier, captive par son caractère évocateur la rapprochant des Lieder du même compositeur. Dans le cas de la Partita no 6 de Bach, ce sont les tempos lents qui surprennent en dérobant aux mouvements leurs racines dans la danse. Pour ce qui est de la constance des pôles harmoniques dictée par l’omniprésence du mi comme centre tonal, elle offrait un point de référence mettant en lumière les différences de traitement dans les styles compositionnels de chaque compositeur.
Si les choix esthétiques surprennent, les moyens techniques mis au service de cette vision biscornue suscitent l’admiration. Les différentes voix se distinguent non seulement par la clarté de leur articulation, mais également par les coloris conferrés. De son toucher parfaitement contrôlé, Olafsson crée une variété de couleurs, des plus franches et résonnantes aux pastels empreintes de nostalgie. Je m’attendais d’ailleurs à ce que le pianiste exploite cette palette de tendres pastels qu’il réussit bien dans le dernier mouvement de la Sonate no 30 de Beethoven, pensant qu’il nous laisserait sur un mouvement serre-cœur. Alors qu’il avait péché par excès d’épanchement dans la Sonate no 27, il a au contraire usé de retenue dans ce mouvement pourtant marqué Gesangsvoll, mit innigster Empfindung (Chantant, avec le sentiment le plus profond), même lors du retour final du thème.
Le paradoxe d’une cathédrale sonore est qu’elle ne peut être revisitée à rebours, une fois son dévoilement complété. Comment savoir dans l’immédiat si tel ou tel détail qui ressort se subordonnera finalement à la logique d’une organisation à grande échelle? Même si la question se pose toujours un peu, il est plus facile de juger de la réponse dans le cadre d’une forme connue ou d’un style d’écriture uniforme. Les réponses individuelles varieront d’autant plus dans le cas d’un récital par un interprète à la personnalité musicale hors norme comme Vikingur Olafsson. Personnellement, j’ai un faible pour les architectures à grande échelle et suis prête à en accepter les aspérités inattendues comme des caractéristiques intrinsèques plutôt que comme des défauts.
Je dois cependant avouer que ma tolérance pour les interprétations hors normes a été épuisée avec les rappels. Dans la transcription faite par Olafsson de l »Entrée pour les Muses, les Zéphyres, les Saisons, les Heures et les Arts » tirée des Boréades de Rameau (« repackagée » sous le titre Les Arts et les Heures), la superposition confuse des lignes descendantes rappellait plus le tintinnabulisme d’Arvo Pärt qu’un quelconque parallèle avec Mahler, annoncé au micro – aucun des deux rapprochements ne réussissant à m’amadouer. En troisième rappel, Le Rappel des oiseaux, également de Rameau, évoquait plutôt des coucous d’horloges mécaniques. Entre les deux, l’Étude no 6 de Philip Glass – une chevauchée aux harmonies faciles relevant de la musique de film – a tout de même fait la démonstration du jumelage idéal entre Vikingur Olafsson et le Steinway de la Salle Bourgie, qui répondait à toutes les demandes du pianiste, même dans les répétitions de notes les plus rapides.