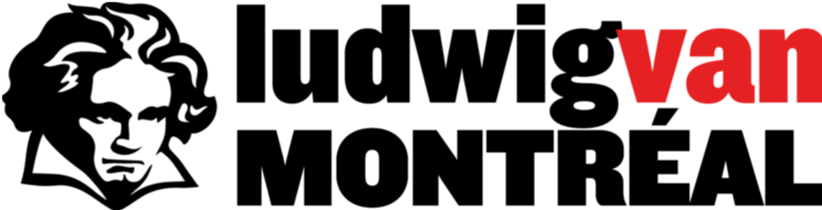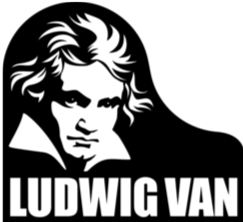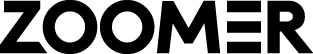Après avoir ouvert avec La Grande Messe des morts de Gossec la semaine dernière, le Festival Classica présentait jeudi soir une rareté d’un autre ordre, l’opéra Der Kaiser von Atlantis (L’Empereur d’Atlantis) de Victor Ullmann, sur un livret de Peter Kien.
Cet opéra expressionniste en un acte a été composé et répété en 1943 alors qu’Ullmann et Kien étaient prisonniers au camp de Theresienstadt. Les représentations en ont été interdites par les nazis après la dernière répétition, une fois que le ton critique de l’oeuvre leur soit apparu clairement. Le compositeur a pu remettre in extremis une valise contenant son manuscrit annoté à un ami avant d’être transféré à Auschwitz, assurant la survie de l’oeuvre.
Synopsis
L’empereur Overall mène une guerre tout azimut insensée, au point que la Mort elle-même, vexée, se rebiffe et brise son sabre, se privant par ce geste du pouvoir de donner la mort aux humains. Les condamnés à mort sont exécutés, mais ne meurent pas; les soldats tombent blessés sur les champs de bataille, mais restent suspendus entre la vie et la mort; les malades souffrent, mais ne peuvent plus espérer la délivrance de la mort. L’Empereur, désemparé de voir son emprise sur son peuple ainsi diminuée, cherche à sauver la face en annonçant qu’il accorde la vie éternelle à tous ses sujets.
Cette impossibilité de mourir a tout de même un heureux résultat alors qu’un soldat et une jeune fille de camps ennemis, incapables de se tuer, tombent plutôt en amour, ce qui va à l’encontre de la pensée dominante. Le Tambour tente de les ramener à des pensées de guerre et de confrontation.

La ruse de l’Empereur n’a pas fonctionné : plutôt que de lui être reconnaissants, ses sujets lui en veulent de ne pas pouvoir quitter ce monde. Poussé dans des directions contraires par les conseils d’Harlequin et du Tambour, l’Empereur demande finalement à la Mort d’apporter le soulagement à son peuple en reprenant ses fonctions. Celle-ci exige qu’il soit le premier mort qu’elle emporte, ce qu’il finit par accepter. Les personnages restants (à ceux déjà mentionnés s’ajoute le Haut-parleur) chantent un choeur final sur la mélodie du choral luthérien Ein’ feste Burg ist unser Gott.
L’interprétation
L’orchestre de chambre, composé du quintette à cordes, d’une flûte, d’un hautbois, d’une clarinette, d’un saxophone, d’une trompette, d’un piano, d’un harmonium, d’un banjo (alternant avec une guitare), d’une caisse claire et d’autres percussions, a offert une prestation solide, avec des combinaisons de timbres réussies. Matthias Maute et les instrumentistes ont clairement accompli un excellent travail de préparation.
Du moment que l’orchestre est placé sur scène pour la présentation d’un opéra, l’équilibre devient une question délicate (plus délicate qu’autrement, devrais-je dire), encore plus lorsque les effectifs vocaux sont placés derrière les instruments. La production d’hier, au cours de laquelle l’équilibre était généralement satifaisant, est l’exception qui prouve la règle : est-ce dû à l’orchestration clairsemée, à la disposition surélevée de la distribution vocale leur permettant de projeter par-dessus l’orchestre ou au doigté du chef? Si c’est le dernier point, on exige que Maute fasse tout de suite connaître son secret aux autres chefs. La caissse claire, même placée en retrait, ne manquait pas de se distinguer par des attaques et des roulements violents, mais c’est probablement une exigence de la partition.

Tous les chanteurs et chanteuses ne contribuaient pas avec autant de succès au mélange chant/orchestre. Inévitablement, certaines voix, plus sombres ou chantant dans un registre moins avantageux, se démarquaient moins. C’est malheureusemement le cas de Frédéric Caton, qui manquait de présence dans le rôle pourtant central de la Mort. Éric Laporte s’est montré à l’aise dans le rôle d’Harlequin, possédant d’ailleurs la meilleure prononciation allemande de la soirée (le niveau de la compétition n’était pas très élevé de ce côté, doit-on dire, variant chez les autres membres de la distribution entre incompréhensible et laborieuse). L’autre ténor, très bon Emmanuel Hassler, a brillé entre autres dans son trio avec la Jeune fille de Sophie Naubert, remarquable, et le Tambour de Florence Bourget, démontrant une belle égalité de timbre dans tous les registres. La prononciation laborieuse de Tomislav Lavoie posait une entrave à une appréciation libre de son rôle de Haut-parleur autrement bien rendu. C’est à Pierre-Yves Pruvot qu’a été confié le rôle de l’Empereur, dont il s’est acquitté avec succès, en particulier dans le long numéro qu’il doit soutenir seul.
La scénographie, constituée uniquement de projections, tirait profit de la forme concave de la scène et des avancées blanches autour des loges pour former un grand écran sur lequel étaient projetées de grandes images. On peut débattre de l’à-propos du premier visuel, nous donnant l’impression d’être à bord d’un train arrivant à un camp. L’image d’un immeuble détruit par une bombe, elle, faisait un lien efficace avec les images de notre actualité présente, semblant provenir d’Ukraine ou de Syrie.
Présentation pré-concert
En deuxième partie de concert était jouée la Symphonie pour orchestre de chambre no 1, « Remember to Forget » de Jaap Nico Hamburger, compositeur néerlandais habitant à Montréal depuis 2000 et compositeur en résidence de l’organisme Mécenat Montréal. L’oeuvre en deux mouvements correspondait dans son idiome exactement à ce à quoi on peut s’attendre de la part d’un compositeur ayant reçu (pour une autre oeuvre) une commande de l’Organisation des nations unies, c’est-à-dire de la musique correcte et passe-partout.
Là où M. Hamburger aurait mieux fait de s’abstenir, c’est dans sa longue et inepte présentation pré-concert, qui n’avait comme point positif que d’être présentée en bon français par quelqu’un de qui c’est la troisième langue. N’empêche, quand on se donne autant d’efforts pour une présentation, il faut éviter de dire des âneries. Faire autant de généralisations grossières au point d’être erronées et de faussetés fondamentales dans une salle associée à un lieu d’enseignement supérieur proposant non seulement des programmes de musicologie, mais aussi le seul programme en médiation de la musique au Canada, c’est insulter l’intelligence et les efforts – j’allais chercher à préciser de qui, mais de tout le monde en fait.
Tout d’abord, M. Hamburger n’a jamais précisé de quelle musique il avait entrepris de brosser une vague histoire. Il n’y aucune réelle façon d’affirmer avec une quelconque crédibilité qu’à l’Antiquité, la gamme avait cinq notes (pentatonique) et qu’au Moyen-Âge elle en avait sept (modes d’église), laissant entendre que la gamme pentatonique avait disparu avec l’ajout de deux notes supplémentaires, mais au moins préciser qu’on parlait de musique savante occidentale aurait possiblement créer un espace conceptuel où la gamme pentatonique aurait pu continuer de mener une existence paisible dans des musiques autres, existence florissante qu’elle menait avant l’Antiquité et qu’elle continue de mener dans une panoplie de musiques d’origines multiples.
La suite n’a pas arrangé les choses : semble-t-il qu’à partir de l’époque baroque, la gamme comptait douze notes. Non. Absolument pas. J’imagine que M. Hamburger faisait référence, de la façon la plus maladroite et fallacieuse possible, à l’arrivée du tempérament égal, qui a fameusement permis à Johann Sebastian Bach de composer ses Préludes et fugues du Clavier bien tempéré dans toutes les tonalités. Avant l’établissement du tempérament égal – qui n’est rien de plus qu’une convention, mais une convention sur laquelle repose tout l’édifice de la musique tonale -, ni l’accord juste ni aucun des types de tempérament (façon d’accorder les instruments) qui proliféraient ne permettait d’utiliser toutes les notes chromatiques dans une même oeuvre. Le tempérament égal a changé cela, soit. Mais cela ne veut pas dire que la gamme a subitement explosé pour compter douze notes, bien au contraire. C’est à partir de l’arrivée du tempérament égal qu’a pu se développer ce qui est appelé dans le monde anglophone la musique de common practice, soit la musique tonale, qui repose essentiellement sur une hiérarchie des degrés de la gamme diatonique à sept sons. Pas de musique tonale sans la relation dominante/tonique (V-I).
Il aurait été possible de dire que l’arrivée du tempérament égal a donné accès aux douze notes chromatiques, mais « donner accès à » ne veut pas dire inclure dans la gamme. La gamme est un concept défini, et la gamme associée aux époques baroque, classique et même romantique est la gamme diatonique à sept sons, principalement celle de mode majeur. Affirmer toute autre chose, même par souci de concision (surtout quand la concision est un enjeu!), est une malhonnêteté intellectuelle.
Plus loin dans son exposé, M. Hamburger en est venu à parler de la montée du nationalisme au XIXe siècle, appuyé d’une diapositive simulant un tableau de compétition sportive où Wagner (1813-1883) était mis en compétition avec Debussy (1862-1918) et Elgar (1857-1934) avec Albeniz (1860-1909), façon se voulant humoristique d’illustrer le développement des caractères nationaux en musique. Seulement, M. Hamburger ayant négligé de préciser les dates auxquelles chacun des compositeurs a vécu, comme je viens de le faire ci-haut, cela donnait l’impression qu’ils ont tous vécu en même temps et que la montée du nationalisme s’est produite au même moment dans chacune de ces nations, ce qui est bien sûr faux. J’avoue qu’il s’agit ici d’une généralisation hâtive de sa part, plus que d’une erreur factuelle, mais la solution était, comme je viens de le démontrer, si simple.
Pour en revenir aux erreurs factuelles – car nous n’avions pas épuiser la catégorie… – , Mendelssohn n’a pas composé le choral Ein’ feste Burg. Il l’a orchestré dans le quatrième mouvement de sa Symphonie de la Réforme, commémorant le tricentennaire de la réforme luthérienne. Et si cela avait un sens d’inclure ce choral dans sa symphonie, c’est que la mélodie du dit choral avait été composée par Martin Luther, fournissant un contexte référentiel directement relié à l’événement commémoré.
Tout ce long survol mal avisé de l’histoire de la musique avait pour but (je crois) de conclure par « comme tous les grands compositeurs des années 30, Ullmann savait combiner tous ces éléments des musiques antérieures dans sa propre musique » – ce qui, en soi, est une affirmation douteuse qu’il n’est pas possible de laisser là sans aucune justification. M. Hamburger a poursuivi en faisant la démonstration de comment Ullmann combinait les éléments mentionnés dans sa musique, ce qui est bien. C’est la portion « comme tous les grands compositeurs des années 30 » qui m’irrite. Vraiment? Honegger? Hindemith? La Seconde école viennoise? Il semble que M. Hamburger ne les compte pas aux rangs des grands compositeurs…
Je suis désolée d’avoir passé plus de lignes à vous parler d’une présentation parlée qu’à la musique elle-même. Si jamais vous vous dites « Regarde la longueur de ce que tu as écrit! Jamais il n’avait le temps de dire tout ça, c’est pour ça qu’il est tombé dans les généralisations! », je contre que j’ai dû prendre autant d’espace pour corriger les multiples erreurs véhiculées dans son discours. Il est tout à fait possible de faire moins long si on donne les informations justes et exactes du premier coup.
La portion musicale était, je le réitère, tout à fait méritoire et devrait être reprise afin d’être vue par un public plus nombreux. Mais de grâce, ne laissez plus jamais Jaap Nico Hamburger faire de présentation.
Inscrivez-vous à notre infolettre! La musique classique et l’opéra en 5 minutes, chaque jour ICI
- ENTREVUE | Daniel Bartholomew-Poyser et Obiora déconstruisent le classicisme dans Amber - 30 janvier 2026
- NOUVELLE | Prix JUNO : Aperçu des finalistes dans les catégories de musique classique - 29 janvier 2026
- ENTREVUE | SMCQ : Trois concertos et trois solistes pour le concert Fougue concertante - 29 janvier 2026